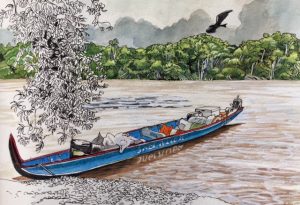Suite à un premier article associé à ses peintures, Aurélien LEPAGE nous adresse un second texte, murmuré comme une odeur suave.
« La nature aime à se cacher.»
De prime abord, cette phrase énigmatique d’Héraclite semble bien peu s’appliquer à ma peinture, tant le végétal y est présent, vivace, ensemençant les surfaces de mille frondaisons, fruits, fleurs et volutes fertiles. Mais à y regarder de plus près, ces feuillages et ces ramures de peinture bruissent de murmures secrets, d’images dissimulées. Tout y est mouvant, polymorphe, incertain, tant au niveau des formes et des motifs que des matières et des gestes. D’autres feuillages apparaissent sous les feuillages, d’autres peintures sous la peinture. Dans la langue originale du fragment d’Héraclite, le mot « nature » est désigné par le terme phusis : c’est la nature dans ce qu’elle a de jaillissant, de contradictoire, de mystérieux, apparaissant et s’enfouissant tour à tour.
J’aime l’idée qu’un tableau ne livre pas son sens dès les premiers instants où il est vu, ou plus précisément qu’il puisse offrir différentes possibilités de lecture, différents niveaux de profondeur. Comme dans un jardin, comme dans un tapis – deux sources d’inspiration pour moi –, les formes végétales dissimulent autant qu’elles révèlent, invitant à se perdre avec gourmandise parmi les entrelacs et les ombres, afin, peut-être, de laisser peu à peu affleurer les voix inaudibles, celles de la nature, des saisons, du cosmos – autant de voix que nous ne prenons plus assez le temps d’écouter.
Dans ma peinture, le végétal prend volontiers un aspect ornemental, voire décoratif, à la manière d’un papier peint ou d’une nappe brodée – autres sources d’inspiration importantes. Je sais que la plupart des artistes ont en horreur ce terme, « décoratif », car il désigne ce qui n’a d’autre intérêt que sa propre joliesse, d’autre visée que l’habillage superficiel d’une surface. Cela peut surprendre, mais j’aime que ma peinture puisse donner cette impression, parfois, aux yeux de regardeurs peu attentifs. J’y vois une forme ambivalente de discrétion, une manière espiègle de dire des choses profondes sans en avoir l’air, sans forcer le regard.
C’est tout l’art de la métis grecque qui devient alors visible, c’est-à-dire un art de la ruse, « une forme particulière d’intelligence, de prudence avisée » ainsi que la définissent Marc Détienne et Jean-Pierre Vernant, et qui doit « se faire plus souple, plus ondoyante, plus polymorphe que l’écoulement du temps. » L’idée de ruse n’est pas ici à entendre au sens de tromperie ou de fourberie, mais au sens de souplesse épousant la souplesse du monde, de chatoiement se fondant dans le chatoiement. Cette notion de métis ne serait ainsi pas sans lien avec la phrase d’Héraclite. Il ne s’agit pas de faire du bruit, de s’avancer dans le monde tous oripeaux déployés, de manière tapageuse, mais, dans le silence de l’écoute et de l’observation, d’en épouser au mieux les contours, les rythmes, les mystères. Regarder encore et encore pour voir, sous le masque inoffensif et anodin des choses, les trésors cachés et les abîmes infinis.
Pour reprendre l’exemple du tapis persan, il serait très facile de n’y voir qu’un fouillis de lignes et de motifs purement formels et répétitifs, un objet à déposer au pied de son canapé et à oublier. Décoratif, en somme. Mais si l’on se plonge davantage dans les jeux de symétrie et d’entrelacements des formes, alors c’est la magnificence d’un jardin d’Eden qui apparaîtra, une version réduite et concentrée du paradis et du cosmos – ou, dans le cas d’un tapis à motifs géométriques, un temple, une vision concentrée de la Jérusalem céleste. L’infiniment petit contient l’infiniment grand, le dévoile et le déploie. La répétition des motifs sur toute la surface d’un tapis évoque l’incommensurabilité du monde, son mouvement perpétuel et ses métamorphoses permanentes. Tout tourne et se retourne sur lui-même, comme les astres et les atomes, et l’homme est part intégrante de cette danse cosmique.
Une similaire ambiguïté habite ma peinture, chaque élément y étant tout à la fois polymorphe et polysémique. Ce qui apparaît comme une fleur se métamorphose soudain en étoile, un fruit devient une planète, une constellation se mue en toile d’araignée. Tout est dans tout, s’enversant sans cesse dans un mouvement où le terrestre et le céleste ne font qu’un. Une branche de corail pourra évoquer un arbre, une racine, un cerveau ou un réseau sanguin ; un tronc d’arbre entrelacé sera tantôt une colonne vertébrale, tantôt un fragment d’ADN. De même, je choisis volontairement de ménager un certain flou au niveau de la symbolique des éléments que je mets en scène, afin qu’ils conservent toute leur vivacité, toute leur puissance d’évocation : un buisson pourra être simple buisson ou buisson ardent, un arbre pourra être arbre de vie, arbre de la connaissance ou arbre votif comme il s’en trouve dans de nombreuses régions de France. Ou tout à la fois. Le végétal a ceci d’intéressant qu’il est universel, et permet de croiser les pistes, les cultures, les histoires, de les multiplier comme d’infinis reflets de miroir sur le chemin de la connaissance, suscitant d’infinis et organiques questionnements.
Les matières et les rythmes dont j’use pour élaborer ma peinture empruntent de la même façon le chemin bigarré et énigmatique de la phrase d’Héraclite. Mes tableaux s’apparentent tantôt à des tapis, des nappes, des mouchoirs, des tapisseries, des miniatures ou des céramiques. Art Brut ou art populaire, pièces de décoration ou pièces de musée.
Broderie, collages, papiers de bonbon, terre, lasures, pâte à modeler, bitume, tissus, dentelles, confiture ou café : tout ce qui peut servir à nourrir ma peinture, à la rendre aussi vivante et multiple que le monde, est mis à contribution. Il en résulte des tableaux plutôt matiéristes, où les gestes demeurent visibles et pourtant mystérieux (« comment c’est fait ? » me demande-t-on souvent). Étrange contraste : parler du cosmos en usant d’une peinture très incarnée !
Je peins très lentement, chaque peinture nécessitant des semaines, des mois de réalisation – voire des années, puisqu’il m’arrive souvent de reprendre d’anciennes peintures, ne considérant aucun de mes travaux comme achevés. « Faites-vous beaucoup de retouches ? » demandait Hubert Damisch au peintre François Rouan. « Des retouches ? Mais je ne fais que ça ! » répondait alors ce dernier. Je passe des heures à broder une grande tige végétale, point par point, ou des heures à peindre des petits points qui formeront une planète ou une voie lactée : je me fonds alors dans le rythme des plantes qui poussent, des étoiles qui naissent, dans le flux vivant et fragile de la nature.
Lorsque je peins, et lorsque je peins du végétal en particulier, c’est toujours ce célèbre poème de William Blake qui me revient :
« Voir le monde dans un grain de sable
Un paradis dans une fleur sauvage
Tenir l’infini dans la paume de ta main
Et l’éternité dans une heure »